Il y a environ un mois, nous avons publié une liste de 50 des meilleurs romans contemporains de plus de 500 pages, pour ceux d’entre vous qui ont soudainement beaucoup de temps supplémentaire sur les mains. Mais pour ceux d’entre nous qui ont soudainement beaucoup moins de temps libre, ou qui ne peuvent plus vraiment prêter attention à quoi que ce soit, sauf si c’est a) court ou b) de quoi parlions-nous ? Pour nous, je présente cette liste de 50 des meilleurs romans contemporains de moins de 200 pages.
Pour nos besoins ici, « contemporain » signifie publié (en anglais) après 1970. NB que je ne fais pas de distinction entre les novellas et les romans – je ne suis pas sûr qu’il y en ait vraiment une – mais je n’inclus pas les recueils de nouvelles, ni les livres qui comprennent une novella et des histoires. Enfin, comme toujours, le terme « meilleur » est subjectif, et cette liste est limitée par le temps, l’espace et les goûts littéraires de l’éditeur. N’hésitez pas à ajouter vos propres favoris dans les commentaires ci-dessous.
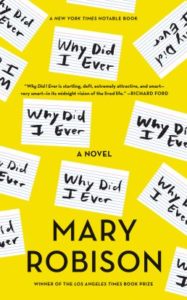
Mary Robison, Why Did I Ever (200 pages)
Probablement le meilleur roman à fragments du moment : la saga de Money Breton, script doctor errant, mère de deux enfants, obsessionnelle, est drôle, irrévérencieuse et étrangement émouvante. Ce n’est pas pour rien, mais ce roman est mon test de coolitude ultime personnel, parce que oui, je suis un adulte qui juge la coolitude des autres, et je le fais en fonction des livres qu’ils lisent.
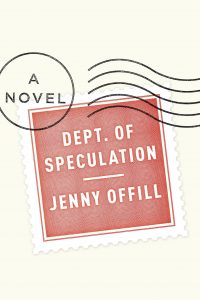
Jenny Offill, Dept. of Speculation (177 pages)
Mon autre candidat pour le meilleur roman fragmentaire récent – sans parler de l’un des meilleurs romans de la décennie, point final – est bien sûr le classique moderne lumineux, vermoulu des yeux (c’est un terme que je viens juste d’inventer pour la version littéraire de vermoulu des oreilles, de rien, et désolé) et constamment sage d’Offill, qui est ostensiblement l’histoire d’un mariage mais qui est surtout l’histoire d’un esprit.
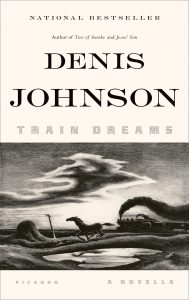
Denis Johnson, Train Dreams (116 pages)
La novella de Johnson est un shibboleth chez un certain type de lecteur (et, typiquement, d’écrivain). Dans notre liste des meilleurs romans de la décennie, le rédacteur Dan Sheehan l’a décrite comme « l’histoire incantatoire d’un bûcheron et ouvrier ferroviaire du début du siècle, Robert Grainier, qui perd sa famille dans un incendie de forêt et se retire au plus profond des bois de l’Idaho alors que le pays se modernise autour de lui ». La prose dépouillée, étrange et élégiaque de Johnson évoque un monde à la fois ancien et éphémère, plein de beauté, de menace et de profonde tristesse. . . . Épopée américaine en miniature, Train Dreams est le portrait visionnaire d’une âme détachée de la civilisation, d’un homme persévérant stoïquement selon ses propres termes hermétiques face à une tragédie inimaginable. Une rêverie hantée et obsédante. »

Han Kang, tr. Deborah Smith, The Vegetarian (188 pages)
The Vegetarian a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa traduction, et la précision de celle-ci, mais comme je ne sais lire que l’anglais, tout ce que je sais, c’est que ce qui est sorti de l’union de Kang et Smith est très, très bon. Dans notre liste des meilleurs premiers romans de la décennie, la rédactrice Molly Odintz a écrit : « Le récit de Han Kang commence par la description d’une épouse dévouée, qui ne se distingue que par son refus de porter un soutien-gorge, et dont la décision soudaine d’arrêter de manger de la viande entraîne son conjoint et sa famille dans une spirale de confusion, où la consommation forcée de viande devient rapidement une métaphore de la violation. La végétarienne entame une lente transformation en légume : d’abord, elle ne mange plus de viande, puis, progressivement, elle ne mange plus rien. Son retrait des plaisirs culinaires est à l’image de son retrait du monde. Elle s’expose au soleil, se fait peindre des fleurs par le mari de sa sœur (un artiste qui n’a pas beaucoup de succès) et tente de devenir une plante. Est-elle sur la bonne voie ou a-t-elle perdu la tête ? Refuse-t-elle le monde ou l’embrasse-t-elle pleinement ? Han Kang laisse les réponses à ces questions délibérément vagues, et le signe d’une grande œuvre est sa capacité à être lue par de nombreuses personnes et interprétée différemment par chacune d’entre elles. »
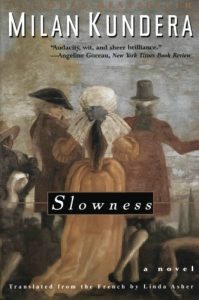
Milan Kundera, Lenteur (176 pages)
Une méditation métafictionnelle sur la modernité et la mémoire – et sur « le danseur », s’exhibant pour l’abstrait « tout le monde », dont le concept devient chaque jour plus pertinent.
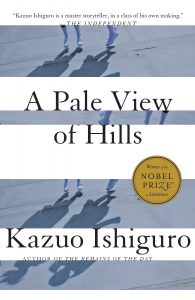
Kazuo Ishiguro, Une vue pâle des collines (192 pages)
Le premier roman d’Ishiguro, publié pour la première fois en 1982, prend forme à travers les souvenirs d’une Japonaise vieillissante, vivant en Angleterre, désormais seule après la mort de son mari. Mais au fur et à mesure qu’elle réfléchit, ses souvenirs deviennent moins sûrs – ou du moins moins moins limités au passé. Comme tout ce qu’écrit Ishiguro, c’est beau, subtil, et pas un peu ombrageux.

Clarice Lispector, tr. Alison Entrekin, Près du cœur sauvage (194 pages)
J’enregistre que c’est une sorte de tricherie, puisque le premier roman de Lispector a été publié à l’origine au Brésil en 1943-mais considérant qu’il n’a pas été traduit en anglais avant 1990, je vais le glisser ici. Après tout, c’est trop glorieux pour être ignoré : la preuve d’un esprit en feu. Nous suivons Joana à travers sa vie dans ce court roman, mais c’est vraiment pour les phrases que vous devriez lire : parfois impénétrables, parfois sauvages, parfois transcendantes.

Susanna Moore, In the Cut (179 pages)
Ok, je vous préviens : ce roman n’est pas pour les dégoûtants. Ma meilleure amie m’a recommandé ce livre il n’y a pas très longtemps et ne m’a rien dit à part qu’il était incroyable, et que c’était totalement une relecture de la fois où elle m’a fait aller voir Hard Candy avec elle en me disant que ça allait être une comédie indé. Et regardez, c’est incroyable, dans le sens où vous aurez des réactions physiques en lisant ce livre, et dans le sens où Moore capture parfaitement une gamme d’émotions et d’impulsions rarement couchées sur le papier. Mais comme… vous n’allez pas vous sentir bien à la fin. Alors sachez-le.
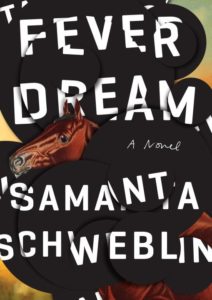
Samanta Schweblin, tr. Megan McDowell, Fever Dream (189 pages)
C’est un roman bizarre et terrifiant, presque étouffant, qui m’a tenu éveillé toute une nuit. Dans notre liste des meilleurs premiers romans de la décennie, notre camarade de rédaction Eleni Theodoropoulos a écrit que dans ce roman, « les détails sont dramatisés par le dialogue, et Schweblin sait exactement ce qu’il faut choisir et ce qu’il faut laisser de côté pour que les personnages comme les lecteurs soient obsédés par l’histoire du poison. Tout le monde est à la merci de quelqu’un : David est à la merci d’Amanda, Amanda à la merci de David, et le lecteur à la merci de tous les deux. La seule façon de découvrir la vérité dans Fever Dream est de faire confiance au récit de quelqu’un d’autre. Même s’il est emporté par l’horrible progression du roman et, simultanément, de la maladie, le lecteur s’identifie à Amanda, une mère qui réalise qu’elle ne peut pas protéger son enfant. En un peu moins de 200 pages, Schweblin a livré un récit poignant et tragique d’une peur devenue réalité. »
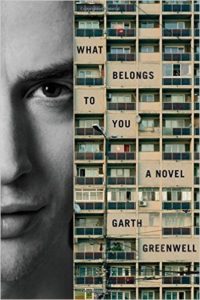
Garth Greenwell, What Belongs to You (191 pages)
Si vous lisez Lit Hub depuis un certain temps, vous savez à quel point nous aimons le premier roman de Garth Greenwell (sans parler de son dernier, Cleanness), qui est, après tout, l’un des meilleurs premiers romans de la décennie. C’est un livre exquis, tant au niveau des phrases que de l’histoire, une œuvre d’art envoûtante.
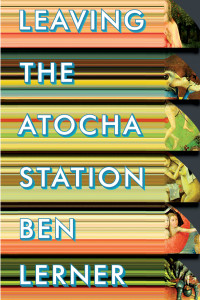
Ben Lerner, Leaving the Atocha Station (181 pages)
J’aime toujours autant le premier roman de Lerner, qui parle essentiellement d’un poète qui n’écrit pas de poésie à Madrid, mais qui est en fait très bon, malgré cela. Dans notre liste des meilleurs premiers romans de la décennie, notre rédactrice Jessie Gaynor l’a décrit comme l’un des « romans les plus subtilement hilarants qui soient » et a écrit que « Lerner invite le lecteur à rire avec son protagoniste aussi bien qu’avec lui. Le roman semble propulsif plutôt que sinueux, comme si le lecteur était celui dont la fraternité s’épuise rapidement. »

Don DeLillo, Point Omega (117 pages)
DeLillo est le rare écrivain qui excelle à la fois dans la forme longue et la forme courte. Celui-ci, son quinzième, est un portrait déstabilisant et irrésistible du deuil réfracté par l’art. Selon moi, du moins – c’est aussi l’un des romans les plus polarisants de DeLillo, alors autant le lire, au moins pour avoir une opinion sur la question.
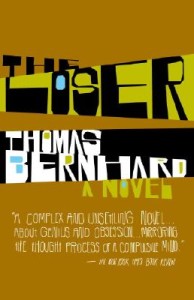
Thomas Bernhard, tr. Jack Dawson, The Loser (190 pages)
Possiblement le meilleur monologue de 190 pages mal luné de la littérature contemporaine, si vous aimez ce genre de choses.

Danielle Dutton, Margaret the First (160 pages)
Ce joyau lucide est le récit à la première personne de Margaret Cavendish, une vraie femme de la Renaissance et écrivain du XVIIe siècle dont l’histoire serait suffisamment captivante en soi, même sans le traitement élégant et clin d’œil de Dutton. Mais les clins d’œil ne passent pas inaperçus, bien sûr (tout comme cette superbe couverture). Dans notre liste des meilleurs romans de la décennie, le rédacteur en chef Jonny Diamond a qualifié le livre de « poignard étincelant de roman » et a écrit que Dutton « réalise les ambitions démesurées de ce livre remarquable avec une efficacité virtuose, tressant des perspectives à la première et à la troisième personne avec des passages de l’écriture originale de Cavendish. Je recommanderai ce livre pendant la prochaine décennie. »
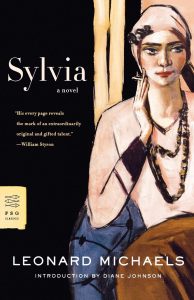
Leonard Michaels, Sylvia (123 pages)
Le roman autobiographique de Michaels est un récit factuel de son mariage avec sa première femme, l' »anormalement brillante » mais dépressive et volatile Sylvia Bloch. En le lisant, on a l’impression de regarder, à travers les yeux clairs de Michaels, un moment de sa vie, au début de la vingtaine, qui a été hermétiquement fermé, de sorte qu’au moment où il raconte l’histoire, celle-ci est devenue une sorte de légende à eau morte. Vous pouvez discerner à peu près tout de suite que cette relation est condamnée, mais il est toujours essentiel de la regarder se dérouler.
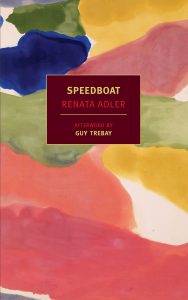
Renata Adler, Speedboat (193 pages)
Si vous êtes un certain type de femme vivant dans un certain type de ville, ceci est une bible. Si vous êtes un certain type d’écrivain avec un certain type de sensibilité, c’est aussi une bible. Le roman ironique et discursif d’Adler est un brillant portrait de New York et d’un esprit singulier et elliptique – le genre de livre qui, si vous êtes un certain type de personne, vous fera regarder tout ce qui vous entoure un peu plus attentivement et prendre des notes comme un fou.
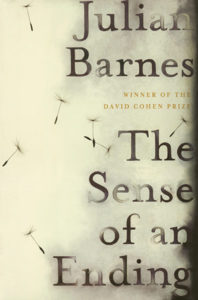
Julian Barnes, Le sens de la fin (163 pages)
Le lauréat du prix Man Booker 2001 est un roman merveilleux quoique mélancolique sur la mémoire, le vieillissement et ce que c’est que de vivre une bonne (ou du moins pas une mauvaise) vie.

Jenny Erpenbeck, tr. Susan Bernofsky, Visitation (150 pages)
C’est un autre livre sur lequel j’ai l’impression de carper tout le temps sur ce site, mais je ne m’en désole pas vraiment. Comme je l’ai écrit dans notre liste des meilleurs romans traduits de la décennie, c’est un livre sur une maison au bord d’un lac à l’extérieur de Berlin – une maison qui est autant le sujet, en tant que lieu dans le temps, que les personnes qui la traversent. « Il y a de petits drames humains dans ce schéma plus grand et plus froid, des drames qui nous accrochent secrètement, même s’ils semblent mineurs, de sorte que nous sommes dévastés lorsque le temps passe, que nous pleurons ceux que nous connaissions à peine, pour leurs fixations, leurs tragédies, leurs épreuves. Élégiaque, souvent d’une stupéfiante beauté, parfois d’une brutalité saisissante, c’est l’un des plus merveilleux romans de toute sorte que l’on puisse espérer lire. »

Yuri Herrera, tr. Lisa Dillman, Signes précédant la fin du monde (128 pages)
Comme je l’ai écrit dans notre liste des meilleurs romans traduits de la décennie, ce livre « ressemble presque à une fable, tant par sa longueur que par son ton : quand on commence à le lire, on n’est pas sûr (ou du moins je ne l’étais pas) d’être dans notre monde ou dans un autre – cela commence par un gouffre, une malédiction et une quête. Très vite, il devient évident qu’il s’agit de notre monde, ou presque, découpé par la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans ce roman, les frontières – entre les mondes, entre les mots, entre les gens – sont à la fois dangereuses et poreuses, les messages insignifiants et profonds dans la même mesure. C’est un livre intense, indélébile, un mythe instantané de l’amour et de la violence. »

Marguerite Duras, L’Amant (117 pages)
J’aime tellement ce roman qu’un jour j’ai fait une playlist pour lui. Et je ne suis pas la seule à être obsédée par ce livre assuré et sévère, que Duras avait initialement prévu comme un album photo annoté de sa jeunesse. « Au fil des ans, j’en suis venue à considérer L’Amant comme un lac sans fond, ou peut-être plus exactement avec un fond qui se déplace sans cesse : chaque plongée permet de comprendre la topographie de manière modifiée et enrichie, et on a le sentiment qu’on pourrait plonger éternellement sans jamais saisir cette topographie de manière absolue », a écrit Laura van den Berg. « À chaque lecture, j’ai été encore abasourdie par un langage à la fois cristallin et énigmatique : ‘La lumière tombait du ciel en cataractes de pure transparence, en torrents de silence et d’immobilité. L’air était bleu, on pouvait le tenir dans sa main. Bleu.' »
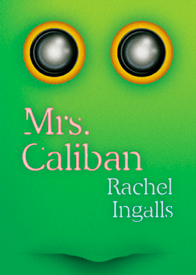
Rachel Ingalls, Mrs. Caliban (125 pages)
Je pense qu’à ce stade, chaque personne de l’équipe du Hub littéraire a lu Mrs. Caliban – le récit faussement simple d’une femme au foyer qui tombe amoureuse d’une mystérieuse créature échappée et en fuite d’un laboratoire gouvernemental – après sa réédition par New Directions pendant l’automne des monstres marins, nous n’avons cessé de nous le passer, les uns aux autres. Notre éditeur Dan Sheehan, qui a interviewé Ingalls avant sa mort, l’a décrit comme « un mélange enivrant de sensualité, de chagrin et d’horreur surnaturelle, et une novella sacrément presque parfaite. »
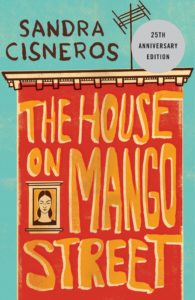
Sandra Cisneros, La Maison de la rue Mango (101 pages)
Le classique éternel d’une fille qui grandit à Chicago.
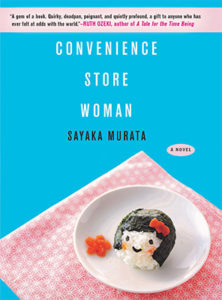
Sayaka Murata, tr. Ginny Tapley Takemori, Convenience Store Woman (176 pages)
Un roman sec et drôle sur, eh bien, une femme qui travaille dans une supérette. Dans notre liste des meilleurs romans traduits de la décennie, la rédactrice Jessie Gaynor écrit qu' »il se lit, tour à tour, comme une histoire d’amour (la femme rencontre le magasin), un manuel de l’employé inhabituellement charmant et un thriller psychologique – mais d’une manière ou d’une autre, il ne semble jamais décousu ». Il était intéressant de lire ce roman au milieu d’une surabondance de livres anglais sur la nature déshumanisante du sous-emploi. Convenience Store Woman ne prend pas, à mon sens, position sur la valeur du travail. Au lieu de cela, il présente Keiko dans toute sa glorieuse étrangeté, et invite le lecteur à s’en délecter. »
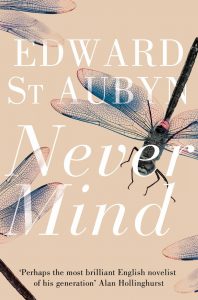
Edward St. Aubyn, Never Mind (197 pages)
Une œuvre poignante de génie – et pour les non-initiés, considérez cela comme le point d’entrée pour de très nombreuses heures de plaisir littéraire.

Anne Carson, Autobiographie du rouge (149 pages)
Le roman en vers de Carson, une relecture d’un mythe grec classique, est l’un de ces livres qui vous réoriente l’esprit, effaçant toutes les règles sur ce que les romans devraient – ou même peuvent – être. Ocean Vuong le cite parmi les livres dont il a eu besoin pour écrire son célèbre premier roman, Sur la Terre, nous sommes brièvement beaux, et écrit : « Ce qui m’inspire le plus dans ce livre, c’est peut-être le refus de Carson de faire évoluer son protagoniste en l’habituant de manière fausse et forcée à des idéaux hétéronormatifs. Geyron, un petit garçon tranquille, artiste et fils à maman, ne devient pas un héros masculiniste pour « résoudre » sa situation de paria. Au contraire, il incarne courageusement son altérité, ou sa « monstruosité », comme l’écrit Carson, par une vision esthétique nourrie d’émotions. C’est un livre qui insiste sur la nécessité de l’altérité en tant qu’agence au lieu de succomber à l’assimilation facile. »
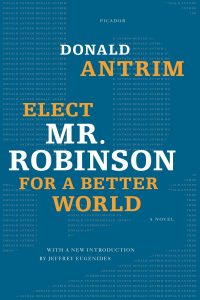
Donald Antrim, Elect Mr. Robinson pour un monde meilleur (164 pages)
Le cauchemar subtropique de banlieue rose stucco d’Antrim concerne une ville devenue folle et l’instituteur déterminé à tout ramener à la normale – bien qu’avec des méthodes très suspectes. Ce mini chef-d’œuvre surréaliste est l’un de mes romans préférés de tous les temps, et l’un des plus drôles, de la manière la plus sombre possible.

Fleur Jaeggy, tr. Tim Parks, Sweet Days of Discipline (101 pages)
Un roman en fait parfait, qu’ailleurs j’ai classé comme le quatrième meilleur roman de campus de tous les temps (donnez-moi un livre, je l’ai classé quelque part). L’histoire se déroule dans un pensionnat de l’Appenzell ; lorsque Frédérique, nouvelle fille dédaigneuse et mystérieuse, notre narrateur est subjugué – et déterminé à la « conquérir ». » La ligne d’Everly est glacée dans sa délibération, et pourtant l’ensemble est brûlant. Ce qui n’est même pas pour mentionner la nouvelle couverture incroyable conçue par Oliver Munday, qui, j’ose le dire, est d’accord avec moi sur les mérites du livre.
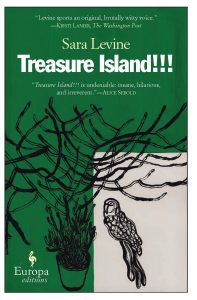
Sara Levine, L’île au trésor ! !! (172 pages)
Un roman vraiment fou sur une jeune femme qui décide de vivre sa vie selon les principes de l’île au trésor de Robert Louis Stevenson, ces principes étant l’audace, la résolution, l’indépendance et, bien sûr, le coup de corne. L’une des expériences de lecture les plus amusantes dont je me souvienne.

César Aira, tr. Chris Andrews, Ghosts (141 pages)
Plusieurs livres d’Aira pourraient être candidats à cette liste – Ghosts est un favori personnel : une famille de maçons squatte un immeuble inachevé, également peuplé, pour ceux qui peuvent les voir, de fantômes. Cela dit, Mark Haber présente également ici un très bon argument en faveur d’Ema la Captive. On peut juste appeler ça le spot d’Aira.
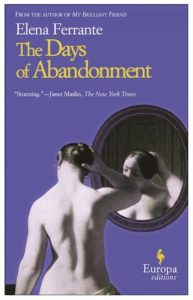
Elena Ferrante, tr. Ann Goldstein, Les Jours d’abandon (188 pages)
Psst. C’est la vraie Ferrante. Je veux dire, regardez, j’aime la série napolitaine autant que tout le monde (bon probablement pas autant que tout le monde mais j’admets qu’ils sont bons), mais à mon avis, ce court roman sur une femme qui se défait est son véritable chef-d’œuvre.
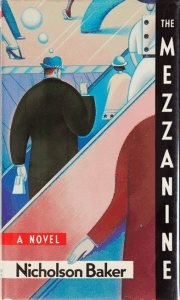
Nicholson Baker, The Mezzanine (145 pages)
Le début hilarant et cérébral de Baker se déroule sur la longueur d’un seul parcours d’escalator, mais il s’avère qu’un seul parcours d’escalator peut en fait contenir des multitudes. Il est à peu près aussi rempli qu’un livre peut l’être d’observations pleines d’esprit, de critiques culturelles et de comportements humains. Et de cartons de lait. (Désolé, mais c’est un de ces livres que vous ne pouvez pas expliquer aux gens, vous devez juste me faire confiance et lui donner un essai.)

Andrés Barba, tr. Lisa Dillman, Such Small Hands (94 pages)
C’est mon devoir solennel de faire du prosélytisme pour ce petit livre vicieux – dans lequel une fille est envoyée dans un orphelinat après la mort de ses parents dans un accident de voiture, et je ne peux plus vous le dire – partout où je vais. Ma dernière victime a été notre rédactrice en chef Katie Yee, qui a écrit dans notre liste des meilleurs romans traduits de la décennie que le livre « se lit comme une logique qui se brise, comme un melon qui tombe sur le sol. C’est le choix inattendu des mots (la ceinture de sécurité était devenue grave !) qui rend cette œuvre à la fois sinistre et agréable à lire. . . . Avec seulement 94 pages, De si petites mains est une lecture cruellement rapide qui vous donne l’impression, de la meilleure façon, que les murs du langage se referment sur vous. »

Susan Steinberg, Machine (149 pages)
Steinberg est un génie méconnu, et son roman elliptique sur un été tragique – une fille, une noyade – devrait être un classique moderne dans la veine de Jenny Offill et Maggie Nelson.
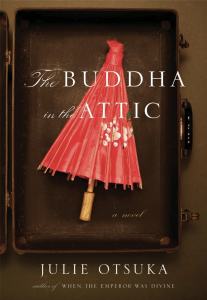
Julie Otsuka, Le Bouddha dans le grenier (144 pages)
Otsuka emploie élégamment la première personne du pluriel pour raconter l’histoire d’un groupe d' »épouses photographiques » japonaises qui viennent en Californie pour rencontrer leurs maris. Dans notre liste des meilleurs romans de la décennie, notre rédactrice Katie Yee écrit que « la narration collective à la première personne correspond admirablement au sujet traité ; elle imite l’expérience de l’immigrant, la façon dont les « autres » sont souvent perçus comme identiques et la camaraderie automatique et la sécurité que nous pouvons trouver parmi ceux qui partagent nos histoires. . . . J’ai relu ce roman de nombreuses fois, en essayant de comprendre comment il peut englober un tel éventail de choses. Ce que Julie Otsuka a accompli ici est à la fois un portrait intime et artistique de vies individuelles et un réquisitoire perçant de l’histoire. »
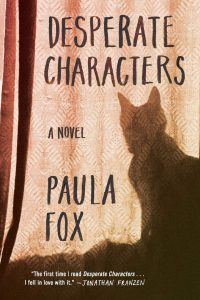
Paula Fox, Desperate Characters (180 pages)
Scraping through with a 1970 pub date, one of my all-time favorite novels about a woman who may or may not have rabies.

William Maxwell, So Long, See You Tomorrow (145 pages)
Bien qu’il soit plus connu pour avoir été l’éditeur de fiction du New Yorker pendant ses jours de gloire, Maxwell a également écrit des nouvelles et plusieurs romans – dont le dernier, un mince roman autobiographique qui a remporté un National Book Award en 1982, était le plus court et le plus grand.

Toni Morrison, Sula (192 pages)
La Sula de Morrison met en scène l’une des amitiés/rivalités féminines les plus durables (et les plus convaincantes) jamais commises en littérature : celle de Sula et Nel, vivant dans » le Bottom » de l’Ohio. Comme le dit Mira Jacob, « ce que j’aime particulièrement dans Sula, c’est la complexité totale de ses personnages féminins. C’est comme si, en lisant ces personnages quand j’étais plus jeune, je voyais pour la première fois qui était au centre des femmes noires. Qui étaient centrées, qui disaient de tout cœur que cette histoire est la leur, et la leur, et la leur, et elles – nous sommes autorisées à être aussi complexes que nécessaire, et à tenir le terrain dans l’histoire. . . . C’est le livre que je garde près de mon lit parce que lorsque les choses n’ont pas de sens, je me tourne vers un seul paragraphe et je médite dessus. Parce que j’ai l’impression que tout est très bien placé, mais même dans ce contexte, je ressens un sentiment d’émerveillement. Une vraie curiosité pour les gens et leur façon de travailler et ce dont ils sont prêts à se contenter et ce dont ils ne sont pas prêts à se contenter, et la vraie friction de ce à quoi cela ressemble. »

Jeanette Winterson, La Passion (160 pages)
Un petit conte de fées historique sournois, dans lequel une pickpocket vénitienne aux pieds palmés nommée Villanelle a perdu son cœur (littéralement) auprès d’une noble, et un soldat trébuchant nommé Henri va tenter de le récupérer.

James Welch, L’hiver dans le sang (160 pages)
Dans le brutal et célèbre premier roman de Welch, notre narrateur sans nom, un jeune homme vivant dans la réserve de Fort Belknap, dans le Montana, cherche à la fois à se connecter à sa tribu, à son histoire, à sa culture, à sa famille fracturée et à se réaliser de manière indépendante. Comme l’a écrit Reynolds Price dans le New York Times Book Review, « l’histoire qu’il raconte, les connaissances qu’il contient, ont autant à dire sur la désaffection et la perplexité profondes, la fameuse et apparemment incurable paralysie psychique de plusieurs millions d’Américains d’origines diverses, aujourd’hui âgés de vingt à trente ans, que sur tout autre groupe plus restreint. Du permafrost dans le sang et dans l’esprit – pourquoi et comment et que faire ? »

Max Porter, Le chagrin est la chose qui a des plumes (128 pages)
Un roman charmant et surréaliste, et l’une des histoires les plus convaincantes sur le chagrin que j’ai jamais lues.
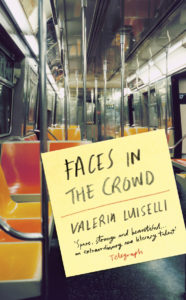
Valeria Luiselli, tr. Christina MacSweeney, Faces in the Crowd (162 pages)
Bien qu’elle ait publié beaucoup de travaux merveilleux depuis, j’ai toujours un faible pour le premier roman de Luiselli, publié à l’origine en 2011 et traduit en anglais en 2014, un portrait frais et convaincant de l’artiste en tant que jeune traductrice prise à contre-pied et retournée sur elle-même.
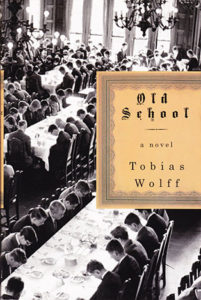
Tobias Wolff, Old School (195 pages)
Un senior sans nom, un internat sans nom, un monde littéraire si proche qu’on pourrait presque l’offenser. Comme l’a dit Michael Knight l’année dernière, c’est le parfait roman de campus (je l’ai classé douzième sur ma liste des meilleurs), qui remplit et transcende à la fois les attentes du genre. « Nous avons ici les bâtiments vieillots mais magnifiques, les arcanes des coutumes du campus, les rivalités et les ambitions des étudiants de son académie exclusivement masculine, le tout rendu dans la prose dépouillée et lucide de Wolff. Nous avons même un cas de plagiat, ce qui n’est guère exotique au genre. Le roman est riche de manière familière tout au long, mais ce n’est que lorsque Wolff change de point de vue dans la dernière section, passant de la première à la troisième personne, de la vie des étudiants à celle d’un professeur d’anglais accablé par un secret qui lui est propre, que le livre s’élève et sort de la tradition du pensionnat pour entrer dans quelque chose de tout à fait plus dévastateur. »
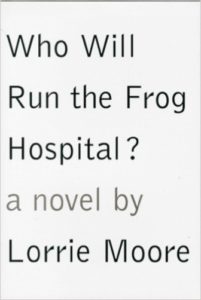
Lorrie Moore, Qui dirigera l’hôpital des grenouilles ? (160 pages)
Dans le deuxième roman de Moore, à l’observation indélébile et sournoisement dévastateur, une femme mécontente en voyage à Paris avec son mari se remémore l’été de ses 15 ans, entraînée par sa lumineuse amie Sils, quand tout était encore possible et excitant – mais bientôt, comme toute chose, à sa fin.
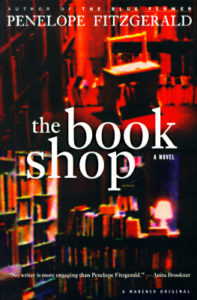
Penelope Fitzgerald, La librairie (118 pages)
Un parfait bijou de roman sur une femme qui ouvre une librairie dans une petite ville du Suffolk, se bat avec un gros bonnet local, et finalement (alerte spoiler) se fait expulser.
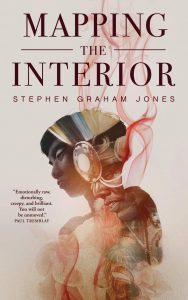
Stephen Graham Jones, Mapping the Interior (112 pages)
Jones est un écrivain extraordinairement prolifique, et c’est un expert de la manipulation des genres ; pas étonnant donc que Mapping the Interior soit à la fois un récit de passage à l’âge adulte et un récit d’horreur, un livre sur la menace, la mémoire et l’espoir.
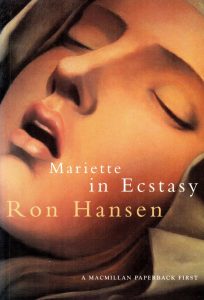
Ron Hansen, Mariette en extase (192 pages)
Le magnifique et précis petit roman de Hansen se déroule dans un couvent catholique romain du nord de l’État de New York en 1906. Dans le Times, Patricia Hampl l’a qualifié de « roman dont la langue est si exquise que le livre court le danger d’être loué uniquement pour sa prose en forme de diamant, qui est souvent aussi agréable que la poésie la plus cristalline ». Et pourtant, Mariette en extase n’est pas seulement un roman de la sensibilité, un simple exercice d’esthète. Car si ses descriptions sont éblouissantes, elles ne sont jamais prétentieuses et ne dégénèrent pas en riffs virtuoses. La plus grande beauté – et la réussite fondamentale – de ce roman saisissant est que son auteur a su trouver une voix entièrement au service de son sujet étrange et insaisissable. »

Grace Krilanovich, L’orange mange les rampes (172 pages)
Je me souviens avoir lu ce roman à sa sortie en 2010, et avoir haleté de manière audible devant l’audace de sa transgression des règles : c’était un roman différent de tout ce que j’avais lu auparavant, et bon sang, c’était amusant, et bizarre, et dégoûtant, et punk. Je n’entends jamais les gens en parler ces jours-ci, mais ils devraient le faire : c’est un livre cauchemardesque, qui fait des embardées et que vous devriez absolument lire si vous avez aimé Fever Dream de Samanta Schweblin.
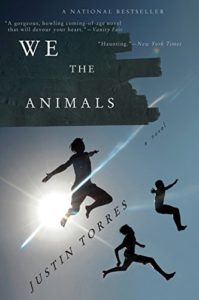
Justin Torres, Nous les animaux (125 pages)
Encore un roman maigre qui a fait partie de notre liste des meilleurs débuts de la décennie – un yawp barbare d’un livre qui célèbre et chante l’enfance dans toute sa gloire crasse.
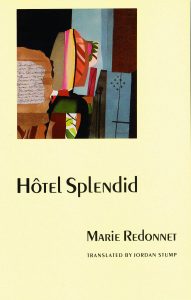
Marie Redonnet, tr. Jordan Stump, Hôtel Splendid (113 pages)
Permettez-moi d’utiliser cet espace pour recommander non seulement Hôtel Splendid, un roman bizarre et charmant sur trois sœurs qui entretiennent un hôtel qui semble déterminé à s’enfoncer à nouveau dans la terre, mais l’ensemble de la trilogie lâche dont il fait partie, les deux autres livres étant Forever Valley, dans lequel une adolescente creuse des trous à la recherche des morts, et Rose Mellie Rose, dans lequel une autre jeune fille dans un paysage en décomposition tente de tracer les grandes lignes de sa vie.
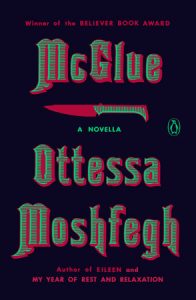
Ottessa Moshfegh, McGlue (160 pages)
La première novella de Moshfegh a remporté le Fence Modern Prize in Prose et le Believer Book Award, mais il semble toujours que personne ne l’ait lue – une honte, mais compréhensible. Plutôt que d’expliquer, je vais vous renvoyer au début de la critique qui m’a donné envie de le lire, qui se lit comme suit : « Le premier roman d’Ottessa Moshfegh se lit comme le jet de cape et d’épée d’une gorge tranchée – immédiat, viscéral, franc, impitoyable, violent et grotesquement beau. McGlue, un ivrogne de passage avec une fêlure dans la tête, se bat (parfois littéralement) contre sa propre possibilité avec la surconsommation, le nihilisme, l’autodestruction et la dépravation totale ». Soit vous êtes dans ce genre de chose, soit vous ne l’êtes pas.
